Cela fait bien longtemps que l’on suit le travail de Jean-Laurent Cassely, journaliste couteau-suisse chez Slate.fr (dont nous apprécions tout particulièrement les papiers à connotation urbaine), et auteur de nombreux ouvrages sur la capitale hexagonale. C’est pour nous parler de son dernier livre que nous avons souhaité l’accueillir ici : dans « La révolte des premiers de la classe« , publié le 12 mai chez Arkhe Editions, Jean-Lolo dresse en effet le portrait d’une mutation sociologique que nous sommes nombreux à observer autour de nous.
En effet, un nombre croissant de jeunes urbains se montrent enclins à quitter leurs « jobs à la con » pour se lancer dans un entrepreneuriat d’un nouveau genre, souvent dans la gastronomie ou l’artisanat. Une mutation sociologique, donc, mais qui semble avoir un impact visible sur le tissu commercial de nos villes : comme le démontre en effet Jean-Laurent Cassely, l’arrivée de ces nouveaux commerçants dans les centres des métropoles résonne étroitement avec des phénomènes de gentrification, que Jean-Laurent a par ailleurs maintes fois commenté sur Slate.
Il n’en fallait pas moins pour nous motiver à lancer cette proposition d’interview à notre « journaliste-ethnologue » favori, et pour balayer avec lui tous les sujets qui nous titillent en ce moment, entre crise des villes moyennes, mutations des centres-villes, et nouveaux indicateurs urbains…
Votre dernier ouvrage tisse un pont très intéressant entre la quête de sens de certains jeunes urbains diplômés, et les mouvements de gentrification que connaissent la plupart des métropoles françaises et occidentales. Comment l’expliquez-vous ?
Les diplômés du supérieur, voire les très diplômés (titulaires d’un Master et notamment de grandes écoles) souffrent de ne pas exercer un travail qui les comble sur le plan spirituel, d’où la fameuse « quête de sens ». Un malaise qui s’est cristallisé dans le débat public avec l’expression de « bullshit jobs » ou « métiers à la con », inventée par l’anthropologue David Graeber. C’est la première partie de l’ouvrage, qui tente une synthèse de ce qu’on sait de ce phénomène de fuite des open spaces.
La deuxième partie se penche sur les voies de reconversion de ces « premiers de la classe » qui renoncent à l’économie de la connaissance et à ses métiers de manipulateurs de symboles (comme les a nommés l’économiste de la mondialisation Robert Reich) et autres emplois nomades (comme les appelle un autre économiste, Pierre-Noël Giraud), pour des métiers de sédentaires, en l’occurrence d’artisanat et de petit commerce souvent alimentaire, dans une démarche souvent inspirée d’éthique artisanale et de philosophie localiste, démarche dans laquelle on valorise donc beaucoup le fait-main, l’authentique et l’interaction directe avec les clients – le tout à l’échelle du quartier, qui devient le lieu de référence de l’activité économique.
Le lien entre quête de sens, rupture professionnelle et gentrification s’explique par le fait que les reconversions professionnelles que je décris ont lieu non pas à la faveur d’un « retour à la terre », mais plutôt « à territoire et environnement social constants ». Pour le dire autrement, le cadre sup’ chef de projet marketing digital qui devient fromager ne part pas dans le rural profond, mais s’installe dans le quartier où il habite, à tout le moins dans la même ville, pour des raisons notamment de potentiel commercial. Il y a dans ces villes et dans ces quartiers une clientèle réceptive non seulement à ces productions mais surtout aux valeurs et symboles associés à celles-ci (l’authentique, le local, le terroir, l’hyper-concret).
C’est une sorte de double-gentrification ou de gentrification à deux niveaux. C’est d’abord une gentrification commerciale comme l’appellent les spécialistes, c’est à dire une montée en gamme de l’offre de commerce. Les CSP+ en reconversion sont effectivement souvent portés par la passion, l’ambition de la qualité, du retour aux sources, ils proposent donc des offres plutôt haut de gamme. Ce profil de boutique contribue à la gentrification car l’ouverture d’un certain type de commerce fait souvent l’objet de mentions dans la presse et attire un certain type de clientèle, et peut même dans certains cas jouer un rôle de repère ou de signal que le quartier est en mutation. C’est ensuite, par le profil des commerçants lui-même, une contribution au processus de gentrification de la population. Ces entrepreneurs sont des gentrifieurs comme les autres, sauf qu’ils travaillent sur place au lieu de seulement résider dans le quartier.
Cette corrélation apparente est-elle aujourd’hui objectivement mesurable ? Y’a-t-il des travaux de chercheurs contemporains qui se sont spécifiquement intéressés à ces évolutions croisées ?
Ce qui est objectivement mesuré, c’est la progression de certains types de commerces (de bouche notamment, et de niche) à Paris, notamment avec les enquêtes de l’Apur. Et inversement, la dévitalisation commerciale qui touche les villes petites et moyennes, est largement documentée elle aussi. Pour ce qui est du profil des commerçants, je ne sais pas s’il y a déjà eu des tentatives de décompte du renouvellement sur un même territoire, en tout cas pas à une large échelle.
Depuis quelques années, plusieurs chercheurs se sont par ailleurs penchés sur cette gentrification commerciale. Un colloque y était consacré à Paris en janvier 2017. Pour citer quelques travaux spécifiques, il y avait justement lors de ce colloque un topo très intéressant d’Arnaud Delamarre dont la thèse porte sur les néocavistes parisiens et leur rapport à la gentrification. J’ai aussi assisté l’année précédente à une présentation de Frédérique Leblanc sur le profil des commerçants indépendants dans les quartiers gentrifiés parisiens. Il y a les travaux sur la gentrification de Paris d’Anne Clerval et d’Antoine Fleury.
Des différents travaux en cours, je retiens que les chercheurs se demandent comment et à quelles phases le commerce intervient dans le processus de gentrification. Est-il un marqueur, un vecteur, un accélérateur… Il me semble que le commerce en est également un sous-produit. C’est un peu comme si le profil social de certains quartiers devenait si homogène que certains de ses habitants décidaient de se sédentariser pour jouer le rôle auparavant dévolu à des artisans traditionnels, c’est-à-dire dont c’était la formation initiale.
Après tout, si tout monte en gamme (les rues, les logements, les commerces, les gens), est-ce si surprenant que votre boucher ait un Bac+5 ? J’exagère un peu évidemment, mais vous avez l’idée. Il est donc possible que certaines professions soient chargées de symboliques différentes à mesure qu’elles-mêmes se «gentrifient», en quelque sorte. Un article de Nicolas Nova publié sur pop-up urbain, que j’ai cité dans le livre et dont le titre est tout un programme (« L’hipsterification des assiettes : le retour de l’homme-sandwich ? »), évoque ce prestige social nouveau dont jouissent des occupations comme tenancier de bar ou préparateur de sandwich (certains types de bars et de sandwiches, évidemment).
Le parallèle tentant est évidemment que dans la gentrification « géographique », les anciens habitants sont progressivement exclus de leur quartier. En serait-il de même avec cette gentrification des métiers du commerce, du service de proximité, de la restauration et de l’alimentation ? On en est aux balbutiements du phénomène, donc il très tôt pour répondre, mais la question mérite d’être soulevée.
En parallèle de la gentrification, la crise des villes moyennes semble s’être imposée comme un sujet médiatique fort, et vous l’avez d’ailleurs beaucoup chroniqué sur Slate. Cette mutation est-elle liée aux phénomènes que vous observez dans les grands pôles urbains ?
Oui, et c’est loin d’être anodin à mon sens, car les deux phénomènes s’éclairent l’un l’autre et sont les deux faces d’un même récit cohérent de l’évolution territoriale du pays. C’est frappant : il y a deux visages en tous points opposés de l’évolution commerciale (ils ne correspondent pas toujours à la réalité objective, mais ils donnent une tonalité d’ensemble).
On assiste à une sorte de fracture commerciale. La France des grands centres urbains et des « idéopôles » de plus en plus foisonnante, se rapprochant par son offre commerciale et culturelle d’autres grandes métropoles mondiales. La montée en gamme des commerces de bouche, de la restauration, des bars, le retour à des concepts indépendants en marge des franchises qui ont homogénéisé et standardisé les modes de consommation (mais aussi la vigueur de certains réseaux comme les circuits courts et de consommation responsable ou équitable) s’observe dans ces métropoles où vit une classe urbaine éduquée beaucoup scrutée pour ses pratiques de consommation.
L’envers de cette réussite est une France largement décrite surtout pendant cette campagne présidentielle, souffrant d’une désertification commerciale de ses centre-villes. Le livre d’Olivier Razemon publié l’année dernière, Comment la France a tué ses villes, est une belle enquête consacrée à ce phénomène attristant de dévitalisation commerciale mais aussi de paupérisation. De nombreux rapports sont parus pour documenter ce phénomène qu’on a pris l’habitude de résumer par l’expression de « France moche », qui ne touche certes pas toutes les villes moyennes et petites.
Le paradoxe principal me semble être que les modes de vie fanstasmés comme « villageois » et authentiques : la marche à pied, le vélo sur de courtes distances, les marchés de proximité, les quartiers où tout le monde se connaît, bref tout cet imaginaire à la Amélie Poulain qui obsède les Français depuis des années, a plus de chance de s’expérimenter dans un quartier bourgeois ou gentrifié d’une grande ville que dans un petit bourg gagné par la périurbanisation.
On observe par exemple cet éloignement des aspirations (et des moyens de se les payer) par la présence de chaînes de restauration ou de fast-food indépendants populaires dans les centre-villes paupérisés, très éloignés de l’offre healthy et sophistiquée des grands centres urbains. On peut se demander si à terme il y aura encore un « langage commercial » commun à ces deux France. C’est une fracture assez nette qui n’est pas seulement géographique et sociale, mais aussi culturelle, parce qu’elle est liée aux aspirations de la classe éduquée.
Pour poursuivre sur une tonalité plus politique et faire écho aux commentaires de la toute récente élection présidentielle, c’est dans le cadre de cet environnement urbain renouvelé, qu’on a le plus de chance de se projeter dans un avenir désirable. Les innovations sociales les plus en vue sont urbaines : fablab, coworking, modes de consommation collaboratifs, jardins et agriculture urbaines, etc. Il y a tout un nouveau langage urbain optimiste qui porte ces aspirations mais, également parfois, isole un peu de l’expérience la population qui n’a pas encore totalement basculé dans cet imaginaire – la majorité. Je vois donc des liens assez forts avec le récit plus général de la crise que traverse la société française et avec son « identité malheureuse ».
Évidemment, ce rôle vertueux du petit commerce urbain est en partie (et son pendant, la consommation non vertueuse des périphéries) fantasmé et fictionnel : il suffit de penser au rôle majeur qu’occupe le e-commerce et, plus récemment, la « e-livraison », dans l’approvisionnement des villes pour relativiser le caractère prépondérant du commerce de proximité et l’opposition simpliste urbains sobres vertueux / beaufs consommateurs d’espace et d’énergie.
Comment analysez vous ce rapport entre des dynamiques territoriales assez larges, et des figures isolées censées les incarner ? On en revient à la question de la « mesurabilité » : est-il possible d’avoir des indicateurs objectifs de ces mutations urbaines, alors que les tendances qui les illustrent semblent de plus en plus fluctuantes ?
Certains marqueurs souvent importés de l’expérience américaine sont devenus des emblèmes de la gentrification. Les cocktails, les burgers et les cafés en font partie.
En France, j’ai l’impression que les marqueurs n’ont pas été des pratiques de consommation ni des environnements urbains ou des types de commerce, mais plutôt des populations, en particulier les célèbres « bobos ». De manière très française on est entré par une réflexion puis une controverse, sur le rang social et le statut plutôt que par l’étude des pratiques… On le sait, la corde a été tellement usée aujourd’hui le sens s’est dilué, le terme a été politisé, bref ce n’est plus un marqueur de grand chose.
La série South Park toujours au top lorsqu’il s’agit de taper sur les tendances (ici, dans la saison 19 – de 2015 -, en partie consacrée au phénomène de gentrification de cette petite ville américaine)
Le but ultime des petites expérimentations que j’ai pu mener, par exemple avec l’excellent Mathieu Garnier quand on a utilisé le fichier de l’Insee Sirene pour cartographier les burgers premium ou les salads bars parisiens, c’est précisément de mettre en place ce type d’indicateurs qui pourraient prendre la forme d’un index de vitalité urbaine, disons d’« indice Stan Smith ».
Des chercheurs américains utilisent d’ailleurs les contenus générés par les habitants sur les réseaux sociaux pour prédire la gentrification des quartiers. C’est l’idée porteuse – mais malheureusement jamais vraiment aboutie – d’un « cupcake index ». Aux côtés des approches quantitatives (évolution de la structure de la population des villes et des quartiers) il pourrait être intéressant de disposer de paysages de consommation et de leurs évolutions, comme la notion de « foodscape » (paysage alimentaire).
Vous êtes journaliste et « ethnologue urbain formé sur le tas ». Votre approche, centrée sur les usages des citadins, résonne avec les mues actuelles des sciences de la ville. Quels sont les phénomènes qui vous ont le plus marqué ces dernières années ? Les acteurs urbains ne gagneraient-ils pas à s’intéresser davantage à ces pratiques de consommation ?
J’ai croisé plusieurs centres d’intérêt dans la pratique : les sciences sociales, les tendances urbaines, le journalisme et Internet. Je fais une veille classique sur tout ce que je peux trouver sur les Internets urbains, et la data-analyse ou la cartographie des phénomènes urbains sont des formats devenus classiques dans la presse web anglo-saxonne, sous l’impulsion de sites comme City Lab, ainsi que dans la recherche. Un exemple parmi beaucoup d’autres. Un récent article de The Atlantic (au passage peut-être le meilleur site existant) a réalisé une plongée dans les Instagram des déserts alimentaires, c’est à dire les lieux, nombreux en Amérique du Nord, où les gens n’ont pas d’accès facile à des produits frais.
Cet intérêt et ce prisme quasi-ethnologiques sont moins manifestes en France. Peut-être parce que comme on le sait la France a un rapport compliqué à ses villes ? Et parce que les traces numériques sont plus difficiles à obtenir. Enfin il y a, j’ai l’impression, une préférence pour des thématiques urbaines plus « politisées » au détriment de sujets perçus comme plus légers ou impliquant des populations aisées et jugées frivoles parce que consuméristes.
La consommation – ou plutôt une certaine forme de consommation – étant elle-même une pratique dévalorisée, ou du moins suspecte. Il y a une sorte d’angle mort autour de l’étude des classes moyennes au sens large, soit parce qu’elles ne sont pas perçues comme des sujets politiques pertinents, soit parce qu’elles sont difficiles à situer sur l’axe du bien et du mal (ce qui revient un peu au même), à l’inverse des riches et des classes populaires dont la consommation peut faire l’objet de jugements assez arrêtés.





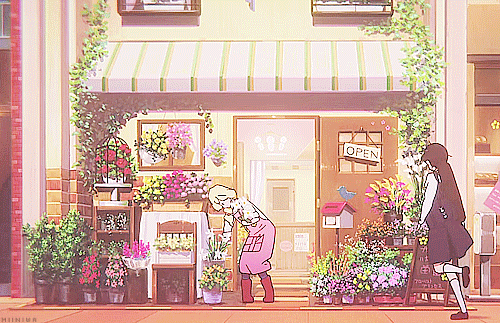










Aucun commentaire.