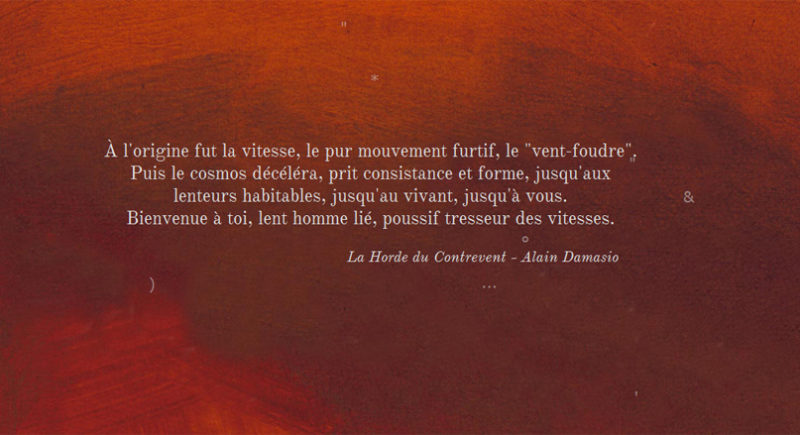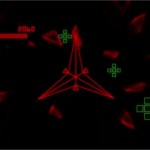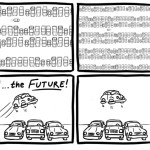[Petite trêve poétique entre deux abécédaires de la ville astucieuse, avant d’y revenir en fin de semaine pour une quatrième et avant-dernière étape. Il sera question de mouvements, flux et vitesses…]
Il est des livres qui bousculent et qui inspirent. Et il y a La Horde du Contrevent. Plus qu’un roman épique, le livre-univers d’Alain Damasio (2004) n’a pas assez de mot pour être raconté. Inutile donc que je vous en dise plus que la quatrième de couverture, tant la lecture se vit et ne se partage pas :
Un groupe d’élite, formé dès l’enfance à faire face, part des confins d’une terre féroce, saignée de rafales, pour aller chercher l’origine du vent. Ils sont vingt-trois, un bloc, un nœud de courage : la Horde. Ils sont pilier, ailier, traceur, aéromaître et géomaître, feuleuse et sourcière, troubadour et scribe. Ils traversent leur monde debout, à pied, en quête d’un Extrême-Amont qui fuit devant eux comme un horizon fou.
Expérience de lecture unique, La Horde du Contrevent est un livre-univers qui fond d’un même feu l’aventure et la poésie des parcours, le combat nu et la quête d’un sens profond du vivant qui unirait le mouvement et le lien. Chaque mot résonne, claque, fuse : Alain Damasio joue de sa plume comme d’un pinceau, d’une caméra ou d’une arme… Chef-d’œuvre porté par un bouche-à-oreille rare, le roman a été logiquement récompensé par le Grand Prix de l’Imaginaire.
Un « sens profond qui unirait le mouvement et le lien »… N’est-ce pas le fondement même de la géographie ? C’est aussi l’une des grandes passions de [pop-up], où nous explorons tant les « valeurs » du mouvement (Contre le mythe de la lenteur salvatrice) que ses imaginaires et ses chorégraphies (ici ou là). Et au-delà de la qualité de l’aventure si finement narrée par Damasio, la Horde nous offre une poésie rare pour alimenter ces réflexions.
A l’instar de ce que nous avions fait avec « L’homme à l’affût » de Julio Cortázar, autre rhapsode ès temporalités, grignotons donc ces quelques extraits mystiques sur le sens du (ou des) mouvement(s).
Le premier fait directement écho à ce difficile vécu flux permanent, qui s’impose à notre « vie liquide » (cf. aussi J comme Jacuzzi) et dont le vent est évidemment la meilleure allégorie. Peut-on seulement y échapper ? Ou cette capacité à ne pas subir le flux ne restera-t-elle, dans nos sociétés, qu’une désir éternellement insatisfait ? Que connaît-on vraiment de la pause parmi le flux ?
« Sitôt qu’Arval sortait du Pack, je me retrouvais insuffisamment abritée, par intervalles soumise au plein vent. J’avais froid, cette impression, que je dispersais mal, d’être progressivement percée à nu et faufilée dans mes fibres […] J’enviais les buissons, l’espace qu’ils s’aménageaient entre les branches pour laisser passer les gros flocons d’air… Depuis que j’étais petite, souvent le même rêve idiot : j’aurais voulu devenir, à ces moments, une haie de buis, pas cette voile de peau en travers du flux, ce tronc à plat sans même de racines aux pieds, pour s’associer à la terre… » (p. 686)
Le second extrait est volontiers plus mystique ; il renvoie directement aux différentes formes du mouvements, dont nous avons aussi tracé quelques lignes en proposant « l’instant » comme forme actuelle du mouvement pleinement maîtrisé. Damasio nous emmène sur cette voie, toujours par la métaphore, et même plus loin encore.
« – C’est délicat à expliquer. Il y aurait comme trois dimensions de la vitesse, qui sont aussi celles de la vie. Ou du vent. La première est banale : elle consiste à considérer comme rapide ce qui se déplace vite. Cette vitesse-là est celle des véhicules, des jets d’hélice, d’un slamino. Elle est quantitative, relative à des coordonnées dans l’espace et le temps, elle opère dans un univers supposé continu. Appelons-la, cette vitesse relative, rapidité.
La seconde dimension de la vitesse, c’est le mouvement, tel qu’il se déploie chez un maître foudre de la trempe d’un Silène justement. Le mouvement – ou le Mû comme ils disent eux – est une aptitude immédiate, cette disposition foncière à la rupture : rupture d’état, de stratégie, rupture du geste, décalage. Elle est indissociable d’une mobilité intime extrême, de variations incessantes dans la conscience du combattant, du troubadour, du penseur. Exprimé sur le plan éolien, le mouvement, ce serait la bourrasque. A savoir : non plus la quantité d’air écoulée par unité de temps, la vitesse moyenne, mais ce qui distord le flux : aussi bien l’accélération que la turbulence – ce qui le fait qualitativement changer -, l’inflexion. […] Sur le plan vital enfin, le mouvement, ce serait la capacité toujours renouvelée de devenir autre – cet autre nom de la liberté en acte, sans doute aussi du courage. Suis-je clair ? » (p. 546-545)
Si vous trouvez meilleure allégorie de cette capacité à rebondir sur les contraintes (retard d’un train, par exemple) pour réorganiser ses déplacements, on est preneur… Jamais mieux qu’ici n’ont été racontés ces « opportunismes » qui déterminent la manière dont certains réussissent à ne plus subir les mobilités liquides, mais à les remodeler en fonction de leurs besoins. On retrouve ce qu’on exprimait à l’époque, et que l’on racontera prochainement dans un texte réactualisé :
« L’instantané » décrivait une mémoire figée du temps présent,« l’instantanéité » exprime à l’inverse cette aptitude à rebondir sur l’instant pour maîtriser un temps inédit et malléable. L’instantanéité est appelée à devenir la norme de nos déplacements et plus généralement de nos rapports au temps. Elle exprime ce qu’annoncent la sérendipité les opportunismes : une aptitude à s’adapter aux fluctuations, accélérations et ralentissement du cours temporel ; un propulseur de mobilités intuitives et adaptatives. »
La suite du dialogue est par contre plus complexe à paralléliser avec le réel de nos vies liquides. On vous la laisse là, chacun y trouvera peut-être ce qu’il y cherche…
– La troisième dimension de la vitesse est la plus imperceptible. On la trouve rarement incarnée. […] J’appelle cette vitesse le vif. Elle est adossée, secrètement, à la mort active en chacun, elle la conjure et la distance. Le vif n’est pas relatif à un espace ou à une durée. Il n’opère pas un pli ou une déchirure dans un tissu préexistant, comme l’opère le mouvement. Il est le surgissement absolu. Il amène, dans un vent, dans une vie, dans une pensée, le plus petit écart. Un minuscule apport, à peine un grain, et tout explose… Il faut comprendre que le Mû n’est rupture qu’en apparence, rupture pour une perception humaine, forcément limitée. En toute rigueur, il demeure une transformation continue…
– Le vif, c’est autre chose…
– Le vif, […] c’est la différence pure. L’irruption. La frasque. Quand le vif jaillit, quelque chose, enfin, se passe – » (p. 543)
Hum.