[Avant-propos : ce texte de Nicolas Nova vient compléter nos propres réflexions sur les « hipsterités » ; un sujet d’autant plus épineux qu’il n’en finit de faire l’actualité, mais qui mériterait un traitement plus subtil que celui qu’on lui réserve habituellement. Exemple de socio-anthropologie des hipsters, au prisme de leurs aventures culinaires.]
La gentrification des centres urbains est un phénomène que l’on ne peut manquer de remarquer. La plupart du temps les discussions sur le sujet abordent le coût de l’immobilier, la sur-représentation de certaines franchises ou la colonisation des quartiers par des familles bobo ou des cliques de hipsters moustachus. Ces signaux donnent une impression générale, certes visible, mais qui ne rend pas forcément de la complexité de ces situations.
Une dimension qui m’intéresse davantage, en ethnographe du quotidien, est la présence d’éléments moins saillants à première vue. Je pense en particulier à ce que l’on vous sert dans les food trucks et autres cafés hipsters : cakes aux graines de courges (sans gluten), piadines italiennes avec du jambon dont vous n’aviez jamais entendu parler, bagels au rougail à savourer avec des olives marinées… ou de manière plus symptomatique la présence ubiquitaire des feuilles moirées réalisées sur la mousse de votre grand-crème. L’apparition de ces aliments, de même que le type de personne qui les sert, n’est pas anodin et met en lumière d’intéressantes évolutions urbaines.
Slow Bar, Intelligentsia Venice, photo by Nial Kennedy
Cream leaf par Michael Choi
Un premier enseignement que je retire de ces observations concerne le métissage soigné que recèle les plats servis à Williamsburg (Brooklyn, NY), sur Abott Kinney Bd (Venice, LA). Le choix des ingrédients, la présentation relevant du mariage entre une composition florale et arrangement musical, le goût rétro pour les accessoires de service semblent tous avoir été pensés par une équipe de designers omnipotents. Pensez par exemple à ces jus de fruits proposés dans des bocaux de confiture en verre, ces salades servies dans des bento box décompartimentées, les heirloom tomatoes servies dans une petite cagette en bois, sans parler de la note que l’on vous imprime avec une énorme caisse enregistreuse rachetée au marché aux puces.
Hormis le côté quelque peu stéréotypé et parfois irritant d’un tel cinéma (et je n’ai pas abordé les qualités capillaires des serveurs), il y a un aspect qui me frappe lorsque je visite un de ces lieux: ce que je mange n’est finalement pas mauvais. En gros, « ça a du goût » comme le dirait Alexandre-Benoît Bérurier. Peut-être qu’à force de valoriser le local via les mouvements « slow food », on commence à en voir les effets. Et la différence avec les lieux qui se contentent de mélanger des ingrédients « boeuf-cheval » achetés en gros avec une sauce industrielle n’en est que plus grande. Évidemment ce n’est pas le même prix à l’arrivée et il y a une sélection sociale à l’oeuvre là derrière…
Mais plus que la qualité des mets relevant souvent du subjectif, c’est une autre leçon que je retire de tout cela: l’ouverture de lieux de restauration hipsters et bobos me pose la question d’une revalorisation de métiers qui me semblaient être antérieurement laissés de côté par la classe moyenne. Qu’il s’agisse de food trucks à San Fransisco, Zürich, Londres ou Austin, de cafés fondés par des baristas à la pilosité exacerbée ou de néo-grotto, le taff est pris en charge par des profils qui me semblaient auparavant éviter ce type de professions – une fois oubliée l’époque du job-étudiant, évidemment.
Exemple dans la série américaine Happy Endings, où l’un des protagonistes décide de lancer sa propre baraque à sandwich. Un cas d’école d’autant plus intéressant que la série porte un regard très caustique sur la gentrification…
Dit autrement, il se pourrait maintenant qu’il soit redevenu intéressant et valorisant socialement de devenir tenancier de bar, de café, de sandwicherie. Je ne parle pas ici de restaurants à étoiles ou traditionnels, et encore moins aux franchises de fast-food, mais plutôt de ces nouveaux lieux que l’on voit fleurir au gré de l’embourgeoisement urbain.
L’un des principaux enjeux sociaux, et donc urbains par définition, est d’obtenir une certaine correspondance entre les envies des gens, leurs aptitudes, et leur place dans la société. A cet égard, ce regain d’intérêt pour les métiers de la restauration me semble intéressant puisqu’il montre une revalorisation sociale de métiers mis de côté. Naturellement, on pourra se demander si c’est un phénomène ponctuel, si les lieux créés ne sont pas superficiels, s’ils sont bénéficiaires… ou tout simplement si ce n’est pas trop angélique de voir la gentrification de cette manière.
Update Je viens de voir qu’un livre va être consacré au sujet: A Delicious Life New Food Entrepreneurs. Attendons 2-3 ans et l’on verra fleurir ce genre de publications en France.




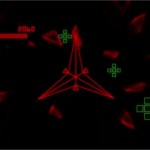


La fascination du hipster/bobo pour la culture populaire ne s’exprime-t-elle pas malgré tout avec le souci de l’entre soi?
Un exemple particulier me viens à l’esprit en lisant votre article: http://popupcity.net/2013/02/new-bangkok-restaurant-brings-street-food-experience-inside/
Le streetfood (objet de fantasme pour le hipster) étant et ayant toujours été une pratique populaire en Thaïlande, les codes sociaux internationaux du hipster cherchent-ils ici un moyen de s’exprimer en dépit de tout? L’objet est idolâtré, les codes réinterprétés, les schémas répétés. C’est le combo du bobo: globalisation, simulation et entre soi?
A vrai dire, je ne sais pas, notamment car la réinterprétation des codes et leur hybridation est un mécanisme courant et standard dans toutes formes de cultures et de classes sociales; et que l’entre-soi n’est pas non réservé à une classe spécifique.