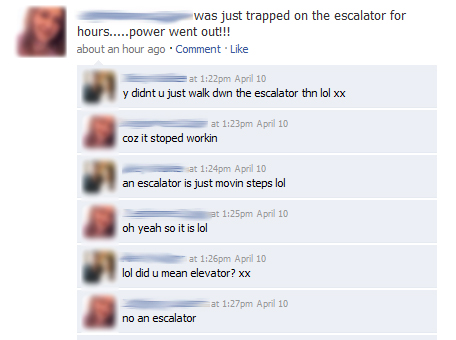[ Avant-propos : Cinquième épisode d’URBAN AFTER ALL, la chronique hebdomadaire que j’anime chaque lundi sur Owni avec Nicolas Nova :) N’hésitez pas à nous suivre sur facebook ! ]
- S01E01 : Le zombie moderne, catharsis d’un urbanisme de classe
- S01E02 : “Masturbanité” : un autre regard sur la ville où t’habites
- S01E03 : Violences urbaines : l’urbanité sacrifiée
- S01E04 : Flirt urbain, graffitis sexuels et géolocalisation
——————————-
La ville a-t-elle pour mission de nous faire maigrir ? La question peut sembler saugrenue. Elle se pose pourtant avec une insistance croissante, malgré un tabou persistant. La surcharge pondérale est en effet devenue, en quelques décennies, l’une des problématiques majeures de santé publique dans les pays développés (= fortement urbanisés), mais pas uniquement. On comptait ainsi 1,5 milliards d’adultes en surpoids et 500 millions d’obèses en 2008. Les prévisions évoquent jusqu’à 2,3 milliards d’adultes en surpoids et 700 millions d’obèses à l’horizon 2015 (Source : OMS)
S’il serait un peu réducteur de rendre la ville seule coupable de cet empâtement globalisé, celle-ci porte indéniablement une lourde responsabilité dans la diminution de nos efforts. L’OMS met ainsi en cause “la tendance à faire moins d’exercice physique en raison de la nature de plus en plus sédentaire de nombreuses formes de travail, de l’évolution des modes de transport et de l’urbanisation”, en plus évidemment d’un enrichissement calorique de notre alimentation. On notera toutefois que la ville n’est pas forcément la forme la plus avachie, comparée aux modèles rural et surtout périurbain où la marche est inévitablement marginale (distances, manque d’aménagements de type trottoirs, etc.)
Pour autant, appartient-il à la ville de nous “faire bouger” ? On admet aisément que les collectivités prennent en charge certaines dimensions de la santé publique, comme par exemple la lutte contre les pollutions. Mais est-ce aussi légitime de s’attaquer à l’effort physique, un domaine longtemps réservé à la sphère intime ? Dit autrement : où s’arrête la responsabilité d’une ville en matière de santé publique ?
La « saine mobilité » en question
Cet hiver a vu naître, dans nos centres urbains, une nouvelle espèce de panneau signalétique, indiquant le temps de marche nécessaire pour rejoindre quelques destinations relativement proches (de 10 à 30 minutes à pied).
Vous les avez certainement remarqués, sans forcément y prêter plus d’attention que ça. Ces panneaux sont pourtant révélateurs d’une tendance forte : la “saine mobilité”, comme l’appelleScriptopolis :
“Les dispositifs de signalétique sont des objets fascinants […]. Équipements essentiels de l’injonction à la mobilité qui caractérisent nos espaces urbains, ils participent d’une fonctionnalisation générale de la ville […] En premier lieu, il s’agit bien entendu d’aménager dans un même mouvement les espaces et les flux d’entités qui s’y déplacent. […]
Récemment, des efforts ont été faits pour inventer des signalétiques qui cherchent à inciter d’autres pratiques vertueuses de la part de la population. C’est souvent un enjeu écologique qui est alors avancé : des panneaux ont été mis en place pour favoriser l’usage des transports en commun, d’autres spécifiquement pour les cyclistes et leur mobilité dite « douce ». […]
C’est aussi le cas de celle présentée ici. Mais son registre est pourtant bien différent. […] Elle vise certes à équiper la marche en informant du temps de parcours […], mais ça n’est pas pour améliorer notre bilan carbone ni avec lui l’air de Paris. C’est au nom de notre propre corps dont, on le sait, nous pouvons améliorer l’état par la pratique régulière d’une activité physique non violente, dont la marche est l’emblème. Voici donc une signalétique qui n’émane pas du ministère des Transports, ni de la mairie, mais du ministère de la Santé. « Bouger c’est facile », indique son sur-titre […]”
On remarquera aussi, en bas du panneau, un lien du site www.mangerbouger.fr, émanation de l’INPES à l’initiative de cette opération ayant pour objectif “d’amener les citadins à intégrer la marche et le vélo dans leurs pratiques quotidiennes” en démontrant “au plus grand nombre que l’activité physique est à portée de tous” (reprenant le slogan “Bouger c’est facile”).
À première vue, rien de grave, me direz-vous. Au contraire, l’initiative donne une visibilité forte aux modes “doux” (marche et vélo, lui aussi inclus dans la campagne d’affiches accompagnant les panneaux). Qui s’en plaindrait ? J’ai justement eu débat à l’époque avec une ex-collègue, n’arrivant pas vraiment à expliquer ce qui me gênait dans cette campagne. Et c’est encore Scriptopolis qui a su mettre des mots sur cet étrange ressentiment :
“S’ouvre avec ces panneaux sanitaires un nouvel horizon de mots d’ordre urbains. On attend avec impatience ceux qui nous permettront de trouver, au fil de nos parcours piétons, les magasins qui nous permettront d’acheter sans faire trop de détour, les cinq fruits et légumes essentiels eux aussi à notre bien-être quotidien.”
On retrouve en effet, dans cette campagne, un nouvel avatar de “l’injonction au mouvement” qui caractérise nos sociétés urbaines (voire aussi là), justifié cette fois par un argument sanitaire difficilement contestable. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’en réfuter les vertus, mais plutôt, comme le fait Scriptopolis, d’en interroger le sens et surtout le sens “caché”, voire inconscient. Si ce type d’initiatives semble donc innocent, la logique qui les sous-tend pose davantage de questions dont il me semble nécessaire de débattre. Exemple outre-Atlantique.
“Fit-City” : et la ville sue
New York, janvier 2010. Le nouveau “Monsieur Santé” de la municipalité, le docteur Thomas Farley, n’est pas en fonction depuis une heure qu’il a déjà ciblé son cheval de bataille : les escalators et les ascenseurs (cf.Next American City – The Architecture of Healthiness).
Les New-Yorkais ont besoin de davantage d’escalier, explique ainsi le Don Quichotte local. On comprend ses motivations : la majorité des citadins et près de la moitié des enfants de la ville seraient en surpoids. En face, c’est le bon sens qui prévaut : “Deux minutes d’effort dans les escaliers permettent de brûler suffisamment de calories pour éliminer la livre (= 0,5 kg environ) que prend en moyenne chaque année un adulte.” Le docteur Thomas Farley a d’ailleurs le sens de la formule : “Si nous avons su mécaniser l’effort physique dans nos vies [avec les escalators et ascenseurs], alors nous pouvons la “dé-mécaniser” tout aussi facilement.” [traduction approximative ; la citation originale : “If we engineered physicality out of our lives, Farley added, “we can engineer it right back in just as easily.”]
Il ne s’agit pas de transformer la ville en salle de sport, mais presque. La municipalité a ainsi produit un cahier des charges de design urbain intégrant l’effort comme composante à part entière de l’urbanisme (intitulé “Active Design Guidelines”). L’objectif : faire suer, tout simplement, en renforçant notamment “l’attractivité des escaliers ou de la marche à pied” (les mobilités “ludiques”peuvent ici jouer un rôle).
“Les citadins feront de l’exercice partout où ils peuvent. Le rôle des designers urbains est de trouver comment leur offrir ces possibilités”, explique ainsi Rick Bell, délégué new-yorkais de l’Institut des Architectes Américains, qui a collaboré au cahier des charges. Logiquement, les escaliers sont au cœur de cette bataille pour la “ville en forme” (“Fit City”) qui se dessine dans ces lignes. Next American City cite ainsi quelques exemples pour en renforcer l’usage : limiter le nombre d’étages accessibles par escalator ou ascenseur au sein d’un bâtiment, ou simplement les ralentir pour en diminuer les “bénéfices” apparents.
Encore une fois, jusque là rien de bien méchant. Sauf que… Qui dit multiplication des escaliers dit aussi difficultés croissantes pour les personnes à mobilité réduite : handicapés bien évidemment, mais aussi femmes enceintes, parents avec enfants et poussettes, personnes âgées, voire même obèses, etc. Autrement dit, à force de vouloir s’investir dans nos vies, la ville ne risque-t-elle pas de créer de nouvelles ségrégations urbaines entre les urbains dynamiques et les autres ? J’avais déjà formulé la question dans un billet pour le Groupe Chronos : dans cette situation, “comment concilier la “livable city” [ville vivable pour tous] avec la “fit city” ?”
Selon Next American City, les handicapés ne seraient pas foncièrement contre une telle politique urbaine. À voir, car c’est ici un responsable de la municipalité qui est interrogé, et on l’imagine mal aller à l’encontre de sa hiérarchie. Les vrais détracteurs seraient plutôt les promoteurs immobiliers, pour qui l’équation “plus d’escaliers = moins d’espace disponible” passe moins facilement. Plus largement, les urbanistes pointent l’inadéquation entre cette politique et la densification nécessaire du bâti :
“Le risque est de finir par promouvoir sans le vouloir de plus faibles densités de bâti car les gens voudront utiliser les escaliers et non les ascenseurs. C’est bien beau de dire ‘nous allons voir comment vous pouvez utiliser les escaliers entre deux étages d’un immeuble de bureau’. Mais en pratique, vous ne réussirez jamais à aller au-delà de quelques étages sans l’aide d’un ascenseur.”
Un risque non négligeable, puisqu’il signifierait la continuation d’un étalement urbain dont les effets pervers sont bien connus. Ajoutons enfin qu’une telle vision “mobilisée” des escaliers nie leur fonction de lieu de pause, que j’évoquais ici.
Au-delà de ces quelques questions qu’il me semble légitime de mettre en débat (à vos commentaires), on peut aussi s’interroger sur cette nouvelle “injonction” du déplacement. Comme le dit un commentateur du billet d’American Next City :
“Brillant ? ou effrayant ? Je suis d’accord pour dire qu’il faut encourager les personnes à prendre les escaliers. Mais utiliser la signalétique et le design urbain pour “forcer” les gens à le faire… il me semble que ça va trop loin.”
Avec le durable et maintenant la santé, la ville étend ainsi progressivement (et subtilement) sa sphère d’influence sur nos vies. Sans entrer dans une paranoïa digne de Philip K. Dick, il me semble pertinent de questionner cette évolution. Nicolas traitera d’ailleurs, dans un prochain billet, de la multiplication de ces “interactions moralisantes” et de l’environnement anxiogène qu’elles peuvent contribuer à créer.