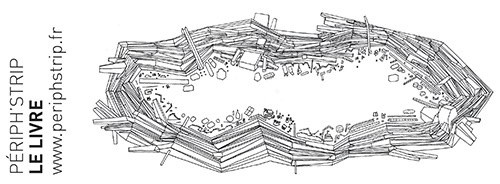Vous en avez peut-être entendu parler sur notre page Facebook ou la leur : le premier Periph’Strip, « Tour Operator du périphérique de Toulouse » initié par le collectif Urbain trop urbain, a eu lieu samedi dernier… On espère que les heureux veinards qui auront eu l’honneur d’y participer nous rapporteront leurs impressions sur cette journée d’exception ! Pour les jaloux et les amateurs qui n’ont pas eu ce plaisir, leur ouvrage polyphonique Périphérique Intérieur sort officiellement au mois de novembre chez Wildproject, histoire de prolonger l’aventure jusque dans les bibliothèques. Afin de vous convaincre, on vous propose de vous initier à leur prose tout en douceur : voici les réponses des deux fondateurs d’Urbain trop urbain, Claire Dutrait et Matthieu Duperrex. Plongez-vous dans leur approche « auteurisante » d’une entité encore trop mal connue : « l’urbain ».
« Dirigé par Claire Dutrait et Matthieu Duperrex, Urbain, trop urbain se propose depuis 2010 de saisir les métamorphoses actuelles de la ville par des pratiques artistiques et culturelles résolument subjectives, qu’elles soient poétiques ou réflexives. Par des parcours documentés par du texte, du son et de l’image, par des lectures de ville et d’ouvrages sur les villes, de la veille numérique et de l’analyse architecturale, le collectif propose des regards multiples sur la ville et ce qui la dépasse aujourd’hui, l’urbain.
Le collectif Urbain, trop urbain est à géométrie variable selon les projets : il prend la forme d’ateliers créatifs ou d’accompagnement d’écriture à la recherche de perspectives neuves sur la ville, que ce soit des mégapoles étrangères ou des espaces urbains européens.
Littérature & critique, photographie, vidéo, botanique, dessin, peinture, graphisme, urbanisme… Le projet Périph’Strip, dont le livre Périphérique intérieur est issu, a engagé de façon régulière six personnes, toutes membres du collectif Urbain, trop urbain : Matthieu Duperrex, Claire Dutrait, Jean-Yves Bonzon, Sophie Léo, Frédéric Malenfer et Uttarayan. »
À la fin de la semaine dernière s’est déroulé « Périph’Strip, le Tour Operator », une visite du périphérique de Toulouse que vous organisez et animez dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Pouvez-vous nous présenter le projet et la démarche qui vous anime ?
Matthieu Duperrex : Ce Tour Operator est l’un des points d’orgue de notre projet « Périph’Strip », initié en septembre 2012. Tout procède de l’idée de mener des randonnées régulières sur le périphérique intérieur de Toulouse. La rocade toulousaine mesure 35km, sensiblement la même dimension que le périph’ parisien. Mais le paysage urbain y est très différent de ce que vous pourriez voir à Paris : plus ouvert et plus secret à la fois, bien moins dense et urbanisé aussi. « Périph’Strip » a consisté à marcher derrière les glissières, sur les terres de l’exploitant autoroutier (à Toulouse, ASF et l’État se partagent la gestion des trois tronçons d’autoroute qui dessinent le périphérique). Formant un collectif, nous avons tracé petit à petit le « strip » du périphérique, créant un répertoire commun : photographie, prise de notes, herborisation, enregistrement sonore, dessin…
Claire Dutrait : Notre démarche s’est nourrie du parcours à pied : c’est dans la marche que nous avons échangé, modifié, construit… notre sensibilité à ce paysage, sans qu’elle ne devienne complètement commune, heureusement ! C’est très important pour comprendre ce qui a suivi et va suivre, à savoir un ensemble de projets artistiques où, à chaque fois, l’expérience partagée a livré un matériau avec lequel travailler, et non seulement un matériau mais une façon d’engager notre sensibilité à plusieurs.
M.D. : Le Tour Operator, qui s’est déroulé le 20 septembre, est un événement qu’on pourrait qualifier de « grand public », c’est une performance assurée par six membres du collectif Urbain, trop urbain, et qui consiste à affréter un bus de ligne de l’opérateur public des transports en commun toulousains (Tisséo) pour rouler sur le périphérique et partager depuis le belvédère du bus une lecture possible du paysage urbain des marges. Le Tour Operator est « touristique » dans son économie de moyens (la visite organisée en bus et la boutique de souvenirs) et poétique dans son approche de la ville et des pratiques urbaines.
C.D. : Oui, les dialogues entre les peintures sur les vitres du bus, les photos placées au lieu des plans, les événements racontés et les poèmes issus de ce territoire embarquent bien plus loin que sur l’asphalte où le bus roule… c’est ce qu’on a souhaité, en tout cas !
M.D. : Nous désirions ainsi montrer ce qui se passe dans la ville lorsque les pratiques d’écritures (au sens large et au pluriel) infléchissent la représentation de l’espace urbain contemporain. Pour nous, élaborer un paysage dans les marges et les interstices, un paysage qui n’est pas qualifié ex cathedra par des autorités administratives ou par la tradition, c’est à la portée du citoyen en tant qu’il pratique la ville « en artiste », en tant qu’il fait confiance à l’invention narrative de l’espace. C’est en tout cas ce que nous expérimentons ici ou ailleurs.
Justement, que représentent ces objets urbains tels que le périphérique et les autoroutes à vos yeux ? Comment infléchissent-ils vos méthodes de travail, au-delà de la lubie qui consiste à découvrir à pied ces infrastructures ?
MD : S’il y a une obsession, assumée, pour le périphérique de Toulouse et quelques autres infrastructures (l’échangeur de Bagnolet, l’ancien port de Bruxelles devenu zone blanche sur la carte, la muraille d’Istanbul…), il n’y a pas de prévalence d’un objet urbain sur un autre. C’est l’urbain générique, au sens de Rem Koolhaas, qui nous intéresse. La thèse qui résume la démarche du collectif Urbain, trop urbain est simple : la « ville » est un espace qui a trouvé sa limite et qui est aujourd’hui recouvert, enveloppé, débordé par quelque chose de diffus et qui s’appelle « l’urbain ». Remarquez que personne ne vous dira qu’il « habite l’urbain » : on dit toujours qu’on habite une « ville ». Cependant, l’urbain caractérise tous ces espaces diffus ou poreux, imprécis, interstitiels ou immensément vastes (les « zones »), qui ne se réfèrent pas strictement à la notion classique de la ville et de son espace « public ». De fait, la ville libérale qui a remplacé la ville du premier capitalisme pose tout un ensemble de questions, regardant aussi bien le vivre ensemble que les libertés publiques ou la construction matérielle de l’espace. Au point que certains auteurs, comme Françoise Choay, parlent de « mort de la ville »…
En nous baptisant « Urbain, trop urbain », en référence à Humain, trop humain de Nietzsche, nous affirmons cette différence de la ville avec elle-même que désigne l’urbain. En même temps, nous aimons ce dépassement et nous nous sentons en décalage avec la façon dont on « consomme » la ville aujourd’hui, qu’on y dépense, ou qu’on s’y dépense. La démarche de Urbain, trop urbain consiste d’une part à ne pas se contenter des espaces désignés et d’aller voir ailleurs ; d’autre part à créer, solliciter, repérer des pratiques ménageant un autre rapport à la ville que celui de sa consommation. Le parti-pris d’Urbain, trop urbain se résume à cela : le multiple qui nous dépasse est une nécessité, dont il ne faut pas seulement « rendre compte » de façon objective, mais que nous avons à explorer, accompagner, saisir parfois par une écriture elle-même multiple et résolument subjective.
C.D. : Dans le cas du périphérique de Toulouse, il s’agissait de découvrir un paysage qui n’était pas encore constitué comme tel à nos yeux, et de le faire de façon collective. Nous n’en connaissions pas a priori les motifs, ni les lignes, les équilibres, les points de condensation, les atmosphères, les couleurs… Cela nous a amené à renouveler des usages que nous avions des réseaux sociaux numériques. La page Facebook du périphérique de Toulouse, administrée collectivement, a servi de carnet de notes commun : cette page a hébergé nos premières collections d’images, nos premières éditorialisations communes, de sorte qu’un langage partagé, une esthétique collective, ont pu s’initier là.
Plus largement, quand nous partons à la découverte de zones urbaines, l’usage des hashtag #periphstrip, sur Twitter, mais surtout sur Instagram nous permet de représenter ces territoires en prenant soin de ne pas unifier leurs composantes, mais de pouvoir les relier les unes aux autres. L’idée nous est venue assez bêtement : prenant à la lettre l’injonction des concepteurs du réseau social inscrite par défaut sur la zone de texte « Écrire une légende… », nous produisons, sous des hashtags choisis (#urbain_Dunkerque, #urbain_Lyon, #leperiphenresidence…), des écritures composées de textes et de photos de façon continue, sans que cela n’ait été prévu dans l’usage de ce réseau social.
Entre récits de marche, légendes urbaines et poèmes lyriques, ces écritures mettent en œuvre les figures de styles propres à la « rhétorique cheminatoire » mises au jour par Michel de Certeau : l’asyndète et la synecdote. « L’une densifie : elle amplifie le détail et miniaturise l’ensemble » : la photo et sa légende focalisent dans l’écriture l’attention sur un détail qui prend sa valeur signifiante par le cadre et sa désignation. « L’autre coupe : elle défait la continuité et déréalise sa vraisemblance » : chaque photo et sa légende se présentent comme des fragments prélevés, et l’ensemble réalisé par le hashtag, et parfois par de la numérotation pour donner l’idée du cheminement, ne masquent pas les ellipses d’une unité à l’autre.
L’avantage d’un projet collectif, comme l’est celui du Périph’strip, est précisément de maintenir jusqu’au bout ces ellipses et cette pluralité des voix et des regards. C’est important, parce qu’on se fait facilement avoir par les mots : au prétexte de nommer ce territoire « un » périphérique, on court le risque de l’essentialiser… Or le périphérique ne se réduit pas à des questions d’essence, c’est bien cela que nous avons appris !
De nombreuses utopies plaident en faveur d’une destruction du périphérique, par exemple parisien, afin de récréer une continuité entre centres et périphéries. Comment percevez-vous ce type de solutions drastiques ? En un sens, faut-il considérer le périph’ comme une espèce à protéger ?
M.D. : Sur le périph’ parisien, il y a eu récemment un beau travail réalisé par le collectif Babel Photo, à l’occasion des 40 ans de l’infrastructure. Leur livre, Périphérique Terre promise, part du principe que le périph’ tel que nous le connaissons va disparaître et que nous pouvons d’ores et déjà en faire l’archéologie préventive. De fait, le périph’ parisien est de longue date décrié comme « égout à bagnoles » et comme frontière, et il y a eu (trop rarement) des façons amusantes de mener cette critique assez banale.
Le projet de couverture intégrale du périph’ parisien a peu de chance de voir le jour compte tenu du coût d’une telle opération (rien que la porte des Lilas a nécessité 100 millions d’euros de travaux, soit une demi-philharmonie de Paris…). Restent certaines rêveries amusantes. L’Agence TER propose tout simplement de faire du périph’ du foncier à bâtir. Plus jouissif, Alain Bublex avait le mérite de réinvestir les grands imaginaires de mégastructures (Archigram surtout, mais aussi Cedric Price ou Yona Friedman) dans ses photomontages d’anticipation de Paris. Un projet du type de celui de Paul Rudolph, pour la New York Expressway (1967) pourrait en définitive compiler tout ça.
Dans un futur proche ou même à moyen terme, nous serons sans doute loin de ces ambitions utopiques, ville « postcarbone » ou pas. Et il y a fort à parier que nous devions subir encore pour longtemps la vulgate urbanistique de la « couture » et de la continuité urbaine, un ensemble de discours assez médiocre et trop souvent accompagné de mesures symboliques où l’on ne voit pas trop ce qu’y gagne réellement l’habitant et l’usager des espaces publics. La ville contemporaine nous donne hélas régulièrement l’occasion de contempler des homogénéisations fonctionnelles et sémiotiques de l’espace urbain que la communication publique baptise « aménités », « réappropriations », « espaces partagés », et toutes colonisations phytosanitaires dont les urbanistes ont le secret.
Pour notre part, nous nous sommes contentés d’observer le périphérique toulousain. Ce que nous avons constaté invite à nuancer les réflexes conditionnés des urbanistes « couturiers ». Bien sûr que la ville est faite de discontinuités. Mais ce qui compte, c’est l’articulation des seuils et des passages à l’intérieur de cette frontière ou cette clôture. Ce qui compte, ce sont les porosités du territoire, là où se niche la vie, là où sont notamment ceux qui habitent les interstices, de façon précaire mais inventive. On est très loin du non-lieu thématisé par Marc Augé. Le périph’ est habité, on y retrouve les fonctions anthropologiques fondamentales (cuisiner, dormir, faire circuler les ressources) et l’hybridation, courante, des interfaces techniques et de l’humain.
C.D. : Oui, et ce qui nous a intéressés, c’est de trouver aussi des manières nomades ou du moins mobiles, d’habiter et de composer avec l’environnement. Ça change un peu des leçons trop bien apprises à l’école, selon lesquelles « nous » nous serions sédentarisés en 9 000 avant notre ère… Là-bas, au bord du périph’, les habitants ne prennent pas l’habitude de fixer le paysage en se fixant dessus. Bien sûr, on peut supposer que cela est généralement subi : les Bulgares qui se font chasser de la lande où il se sont posés auraient certainement souhaité y rester un peu plus longtemps. Mais ce faisant, on peut supposer aussi qu’ils acquièrent un savoir habiter plus léger, le même que celui des habitants déplacés des mégapoles telles que Shanghai ou Istanbul par exemple, qui changent de paysage parce que c’est la ville toute entière qui se transforme et avale ses propres fondations. Une question d’habitude : savoir vivre dans un paysage mouvant et en faire son habitus… ça peut être utile, à l’ère où la condition humaine est urbaine…
M.D. : De façon plus écologique encore, il serait temps de se défaire de l’illusion qui consiste à croire que parce qu’on supprimerait un élément de notre système technique, les intrications anthropologiques dont il était porteur disparaissent. C’est ridicule. Il faut interroger les réseaux, et pas seulement les objets. Or, faire reculer le bitume et les voitures qui roulent dessus, c’est repousser l’ensemble des passions qui nous font aller d’un point à un autre…
C.D. : …et il y en a : pensez à toutes les raisons qui vous font prendre votre voiture, et que votre raison ne connaît pas !
M.D. : c’est donc augmenter l’énergie déployée pour les atteindre. À l’heure où nous sommes tous soumis à la même existence « atmosphérique », pour reprendre l’analyse de Peter Sloterdijk, ce serait dommage. Nous vivons dans une succession d’habitacles imbriqués les uns dans les autres, et le changement climatique nous indique trop bien cela, non ?
Dans Micromegapolis, epub édité l’an dernier, nous avions déroulé cette problématique au travers d’une enquête sur le système sociotechnique du périphérique de Toulouse. Avec le projet Périph’Strip, son Tour operator, son livre Périphérique intérieur, ses performances Les légendes périphériques, en revanche, si nous n’oublions pas cette dimension, nous ouvrons plutôt un chapitre qui est celui de la construction paysagère et de l’identité narrative de l’urbain.
Y a-t-il d’autres objets urbains souvent déconsidérés, ces fameux « non-lieux » a priori que vous aimeriez arpenter à la manière de votre travail sur le périphérique de Toulouse ?
C.D. : Consacrer un temps relativement long à un projet de ce type, qui se réalise sous plusieurs formes, et par lequel le collectif artistique prenne sens, c’est un luxe. Il y faut de l’amitié, des relations, des soutiens financiers, des partenariats (dans les cas de Periph’strip nous avons bénéficié d’une bourse de création artistique, Toulouse’Up, et construit un partenariat avec Tisséo). Nous sommes bien sûr partants pour renouveler cette démarche sur d’autres objets…
Méthodologiquement en tout cas, la randonnée artistique est un excellent catalyseur d’idées et de poétiques qu’on peut mettre « en friction ». C’est ce qui fait par exemple la qualité immense du projet marseillais du GR2013, initié par notre éditeur, Wildproject.
M.D. Nous nous intéressons à la ville, bien sûr, mais ce qui compte avant tout c’est la disposition dans laquelle nous nous plaçons pour agir, rêver, créer et dessiner des perspectives libératoires vis-à-vis du monde. Ce que nous travaillons, c’est une esthétique, littéralement, une façon de nous rendre sensible à l’époque contemporaine. À partir de la collaboration initiée avec Bruno Latour autour de Gaïa (la figure mythologique de l’anthropocène, cet âge de la planète où l’homme est la principale force agissante) nous avons notamment envie d’essaimer notre dispositif d’enquête. Nous avons le projet d’un travail sur le réchauffement climatique à la Nouvelle Orléans. La question du périurbain nous intéresse aussi, et de façon générale la question des mutations de la mondialisation, notamment du point de vue des espaces logistiques où il y a beaucoup à écrire et décrire.
Pour l’instant, nous sommes encore absorbés par le projet Périph’Strip qui nous assure un calendrier assez fourni, puisque l’aventure continue !