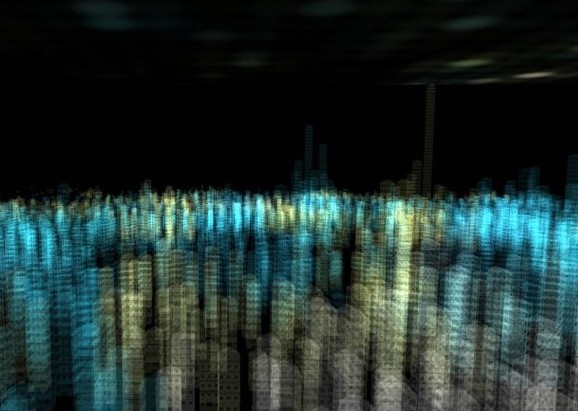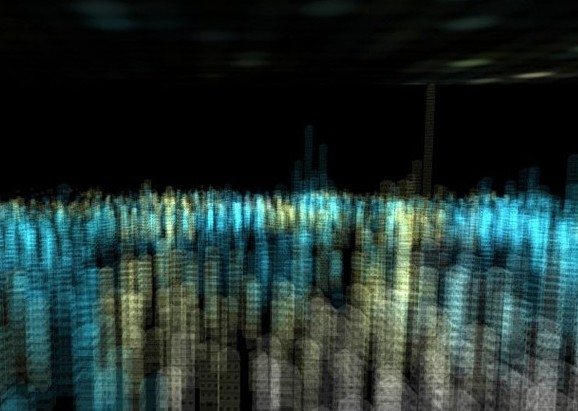Comment « raconter » la ville hybride ? Comment la rendre intelligible pour le commun des mortels, qui n’appartient pas nécessairement au cénacle de connoisseurs ès « ville numérique » ? La tâche est d’autant plus ardue que le numérique est par définition intangible (du moins, perçu comme tel…), et donc difficilement « matérialisable » par le citadin lambda.
MIT SENSEable City Lab 2010. Projet: Network & Society
On retrouve là une dichotomie assez classique, qui distingue le réel-physique du virtuel-numérique. Une opposition évidemment erronée, mais qui contribue à tromper les citadins quant à la réalité du numérique et son impact sur leur quotidien :
« Il devient nécessaire de reconsidérer l’opposition entre réel et virtuel, entre objectivation et fiction dans les modélisations de ville. » (Hugues Aubin)
« Il serait dangereux et anachronique de considérer les technologies de communication numériques comme irréelles. » (Boris Beaude)
La science-fiction, premier conteur de la ville numérique
Nombreux sont ceux qui s’évertuent à retranscrire, par les mots ou les images, la matérialité de cette ville hybride. A ce titre, la science-fiction et plus précisément le courant cyberpunk ont largement contribué à défricher le sujet (Blade Runner, Neuromancien, etc.)
Mais la médaille à son revers : le cyberpunk étant majoritairement dystopique, l’inconscient collectif s’est principalement construit dans une perception relativement frileuse et critique du numérique urbain (exemple avec le jeu Watch Dogs en réaction à l’imaginaire dominant de la Smart City).
On notera d’ailleurs que l’émergence du courant postcyberpunk répond directement à cette vision trop pessimiste des choses (« Avec le cyberpunk, les effets aliénants de la nouvelle technologie sont mis en exergue, tandis qu’avec le postcyberpunk, la technologie est la société »).
Publicités, les nouveaux griots de la ville hybride
La diffusion du cyberpunk dans l’inconscient collectif n’est d’ailleurs pas une mauvaise chose ; elle est même souvent salvatrice, offrant aux citadins une grille de lecture plus critique que les propositions aseptisées que leur offrent les vendeurs de rêve…
Car mis à part le postcyberpunk et quelques courants proches, la plupart des visions « positives » de la ville hybride sont aujourd’hui propagées par des acteurs privés (opérateurs télécoms, grands groupes industriels positionnés sur la Smart City, etc.), pour qui la ville numérique est avant tout un marché à conquérir.
Il en résulte une vision particulièrement éthérée du numérique, se réappropriant ses valeurs (partages, appropriation et hacking, etc.) ; parfois avec tact et élégance (exemple avec Samsung), mais le plus souvent avec davantage de cynisme (encore Samsung).
Encore une fois, cela n’est pas nécessairement une mauvaise chose ; mais il est nécessaire de rester vigilants face aux discours sous-jacents que distillent ces représentations dans l’inconscient collectif.
Roland Barthes et la ville liquide : vieux pot, meilleure soupe
Il reste assurément, entre ces deux visions polarisantes, la place pour un autre imaginaire, plus proche du quotidien et de sa banalité (cf. Plaidoyer pour une utopie pudique). Cela ne signifie pas pour autant d’atténuer la part de « magie » qui confère à la ville numérique son caractère désirable et futuriste.
Malgré leurs qualités certaines, les exemples cités plus haut n’ont pas réussi à restituer cet onirisme de l’infra-ordinaire, qui conjugue le naturel et l’imaginaire, le présent et le futur, le réel et le projectif, et permet ainsi de rendre palpable cette ville numérique qui nous entoure sans qu’on ne l’aperçoive. C’est là que Roland Barthes intervient.
On connaît les vertus intemporelles des « Mythologies » de Barthes, qui n’ont pas pris une ride malgré leur demi-siècle de maturité (1954-1956). La ville n’aura pas échappé au regard affûté du sémiologue, qui prenait le prétexte de la grande crue parisienne de 1955 pour en explorer les imaginaires.
Nulle question du numérique sous sa plume, évidemment. Mais on peut voir, au travers de ses lignes, la plus parfaite analogie de la ville hybride (ou de la ville liquide, comme on l’appelle ici…) : une réalité invisible qui contribue à transformer la perception que l’on a de la ville, et non la ville elle-même.
[L’inondation] a dépaysé certains objets, rafraîchi la perception du monde en y introduisant des points insolites et pourtant explicables. […] Cette rupture a eu le mérite de rester curieuse, sans être magiquement menaçante. […] La crue a bouleversé l’optique quotidienne, sans pourtant la dériver vers le fantastique ; les objets ont été partiellement oblitérés, non déformés : le spectacle a été singulier mais raisonnable.
C’est précisément comme cela que la ville hybride notre quotidien : en renouvelant nos pratiques et nos imaginaires sans pour autant les bouleverser véritablement. Qu’on pense par exemple aux réseaux sociaux géolocalisés, qui ne font *que* maximiser des pratiques séculaires (les interactions de quartier), mais leur confèrent une échelle inédite (possibilité d’interactions démultipliées). Evolution, mais pas révolution : voilà le vrai visage du numérique urbain.
Et le monde est à moi
Comme l’expliquaient Boris Beaude et Hugues Aubin, la ville hybride est justement le fruit d’un croisement, et non la substitution d’une ville numérique à une ville physique. A l’instar d’une inondation, qui irrigue les rues mais ne les remplace pas pour autant.
[…] L’appropriation de l’espace est suspendue, la perception est étonnée, mais la sensation globale reste douce, paisible, immobile et liante ; le regard est entraîné dans une dilution infinie ; la rupture du visuel quotidien n’est pas de l’ordre du tumulte : c’est une mutation dont on ne voit que le caractère accompli, ce qui en éloigne l’horreur. […] Fait paradoxal, l’inondation a fait un monde plus disponible, maniable avec la sorte de délectation que l’enfant met à disposer de ses jouets, à les explorer et à en jouir.
On retrouve ici l’essence même de la ville hybride : qui dit nouveau territoire, dit exploration. Car la plus grande transformation de la ville numérique ne réside pas dans les pratiques (qui changent donc d’échelle, pas de nature), mais dans la mutation du territoire en « laboratoire » à ciel ouvert.

Il y a encore quelques années, un territoire urbain se définissait par des fonctions bien précises : habitat, commerces, loisirs, etc., et les gouvernants planifiaient en conséquence. Mais le numérique est venu y mettre son grain de sel, forçant les territoires à s’adapter en admettant leur nécessaire évolutivité (et en faisant de cette évolutivité un levier d’attractivité non négligeable…).
Autrement dit, à prendre acte du numérique pour se renouveler, et passer ainsi d’une planification rigide à un processus d’expérimentation agile (cf. Saskia Sassen). Exemple avec le positionnement du Grand Lyon, « territoire d’expérimentation » : chaque projet urbain a aujourd’hui pour vocation, outre ses fonctions de base (habitat, loisirs, commerces), à s’inscrire dans une processus d’innovation plus global, et donc à servir de socle/catalyseur à l’innovation future.
Le territoire devient ainsi un laboratoire à ciel ouvert, sous l’impulsion du numérique invisible. Et c’est précisément ce que concluait Roland Barthes en énonçant le véritable pouvoir de l’inondation, dont le passage nous rappelle « l’évidence que le monde est maniable. » Une réalité trop souvent oubliée.