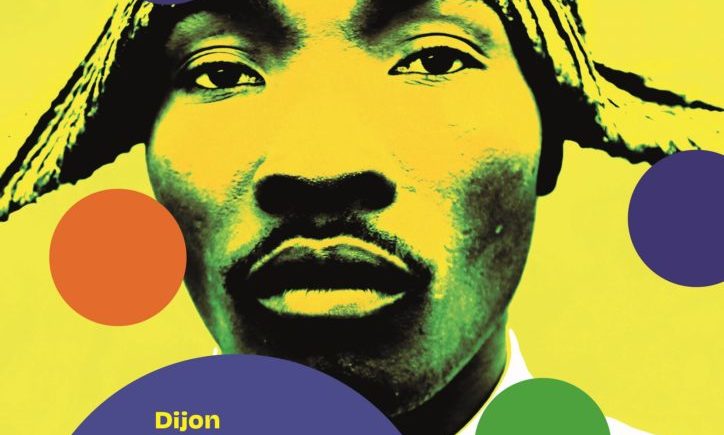De passage à Dijon à la fin du mois de juillet, nous en avons profité pour visiter une petite expo gratuite qui se déroulait dans la Grande Orangerie du parc de l’Arquebuse, jardin botanique municipal de la Cité des Ducs. L’exposition temporaire se présentait comme une sorte d’étape de voyage dans la capitale d’Haïti, Port-au-Prince. Après avoir visiblement réalisé une poignée d’expositions sur d’autres villes du monde comme Dallas, Kinshasa, Dubaï, les grandes métropoles africaines et chinoises, le collectif-organisateur dijonnais Archidb proposait un nouveau stop au coeur d’un corps urbain aux contours méconnus.
Que connaissez-vous d’Haïti aujourd’hui mis à part la violence et le chaos socio-politique qui y règnent depuis trop longtemps ? Quelles images a-t-on de l’ancienne dite « perle des Antilles » en dehors des décombres des séismes qui dévastent l’île trop régulièrement ? Quels témoignages nous parviennent enfin de cette partie des Caraïbes si ce n’est la voix meurtrie des écrivains et artistes natifs qui rapportent régulièrement, dans des textes sanglants, les multiples catastrophes qui la touchent ?
Scène de protestation populaire prise par le photojournaliste Johnson Sabin avec sa série « Petrocaribe, peyi bloke »
Peu d’expressions contemporaines d’Haïti (qui ne soient pas ces décors et ces événements tourmentés) circulent finalement dans l’imaginaire collectif occidental. C’est pourquoi nous sommes ravis d’avoir pu visiter cette expo a priori modeste et pourtant riche d’enseignements.
L’urbanisme précède l’artiste
L’exposition se déroulait en deux parties : un couloir avec des œuvres d’art contemporaines variés (dessins, peintures indigénistes, sculptures, objets d’art fabriqués avec des matériaux recyclés etc.1) et une projection de photos2 accompagnée de documentaires audios dans une salle pourvue de quatre grands écrans. Dans la partie introductive, des écriteaux explicatifs légendaient l’ensemble des œuvres exposées.
Sculptures et dessin à caractère sacré
Drapeau cérémoniel vaudou en sequins
Etonnamment, le registre de leur contenu était très urbanistique. Pourtant, les créations affichées ne représentaient ni vues urbaines, ni cartographies ni quoique ce soit d’explicitement citadin. Malgré tout, la documentation dédiée avait tout d’un cours d’Histoire sur la plannification des rues et l’urbanité de Port-au-Prince. « Nous cherchons à montrer qu’il existe une relation entre les formes urbaines et les comportements sociaux, économiques et politiques des populations. Nous souhaitons également saisir l’esprit des villes que nous traversons grâce à des travaux d’artistes, de chercheurs, d’auteurs et de documentaristes. », précisaient les créateurs de l’événement.
« Port-au-Prince est formé de seizes collines, souvent boisées, regardant la mer turquoise des Caraïbes » nous dit le texte introductif de l’expo. Sur cette photo projetée à cette occasion, on devine les collines alentours et la « ville informelle » (devenue ville officielle) qui s’étalle dans les hauteurs.
Rien d’étonnant finalement lorsqu’on comprend que le nom complet de l’organisme à l’origine de l’expo n’est autre que « Architecture Dijon Bourgogne« . Parmi les écriteaux qui accompagnent les œuvres de la première salle, l’un s’intitule « Ville vernaculaire versus clônage urbain »et nous raconte le développement de la ville porté par les habitants plutôt que par une planification communale. Un autre titre « La rue : de Port-au-Prince à la ville médiévale en Europe » qui définit ce qu’est une rue et son rôle dans la ville d’hier et d’aujourd’hui. Le plus intéressant reste cette comparaison entre la rue médiévale occidentale – étroite et où tout se fait à pied – et les rues des bidonvilles qui se forment à Port-au-Prince (où 90% de la ville s’est construite de manière informelle) et ailleurs principalement dans les métropoles d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique de nos jours.
Maisons coloniales, qui ressemblent plutôt aux habitations de la ville de Jacmel, au Sud-Ouest de Port-au-Prince
A noter également, de très beaux textes dédiés à la capitale haïtienne signés d’autrices et auteurs nati.ve.f.s parmi les plus connu.e.s : Dany Laferrière, Yannick Lahens, Jean d’Amérique, Lyonel Trouillot.
« Il est des villes qui aboient et d’autres qui chuchotent. Il est des villes qui sourient et d’autres qui font la gueule. Des qui se peinturlurent comme une fille condamnée à faire le trottoir se déguise chaque soir pour partir au combat. Et d’autres qui ne montrent rien, qui ne vendent rien, ne font pas dans le show off ni dans la devanture, mais sourient sans forcer quand passe un visiteur. » – La belle amour humaine de Lyonel Trouillot, 2011.
Pour saisir l’esprit d’une ville, rien de tel, donc, qu’un mélange bien dosé entre des notions d’urbanisme et une sélection variée d’œuvres conçues par des artistes et écrivains locaux.
La rue c’est la vie
Mais ce qui nous a le plus clairement fascinés et décidés à écrire ce billet, ce sont différentes séries de photos mises en avant dans la deuxième salle d’exposition. En tout, onze séries étaient projetées à la suite et en boucle, chacune sur l’un des quatres grands écrans installés3. Parmi la dizaine de photographes exposés, certains sont bien référencés, d’autres émergents, voire peu connus4. Les différentes séries traitent de sujets divers, certains qui nous intéressent directement, d’autres plus éloignés des thématiques urbaines. Ce qu’on en tirera ici est donc loin de former un compte rendu exhaustif de l’exposition.
Scène de hoverboard dans une rue de Port-au-Prince
La première chose que l’on peut observer à travers la quasi-totalité des séries de photos exposées est que la rue accueille un bon nombre des pratiques de la vie haïtienne. Certaines photos comme celle ci-dessus racontent des scènes de ville courante comme on en voit partout dans le monde, y compris chez nous (à Paris aussi bien que dans une petite ville de province).
Photo de manifestation extraite de la série « Petrocaribe, peyi bloke » de Johnson Sabin
« Pendant trois mois, en 2019, Haïti a été littéralement bloqué par des manifestations qui exigeaient le départ du président Jovenel Moïse mais aussi que des comptes soient rendus par des politiques, qui ont non seulement échoué dans leur tâche mais ont aussi allégrement pillé les caisses de l’État. Sur les barricades, dans les défilés denses qui structuraient Port-au-Prince, des mélodies surgissaient, des rythmes compulsifs, comme si les slogans forcément devaient ici être chantés. » – Voir : « Haïti, l’île enchantée« , un reportage sur la musique de rue haïtienne par Arnaud Robert et illustré par Georges Harry Rouzier
Soirée « raboday » organisée sur un trottoir / © Georges Harry Rouzier
C’est la même chose pour les soulèvements populaires, les carnavals et soirées en plein air : la rue accueille sans surprise toutes sortes de mobilisations festives ou contestataires, à l’image de la plupart des grandes villes caribéennes, afro-latines et du monde entier. La ville comme décor événementiel, c’est de fait l’un des thèmes que l’on croise chez tous les photographes exposés à cette occasion.
De la vie au cimetière, du cimetière à la ville
La rue où l’on vit en Haïti n’est pas seulement celle des vivants. Il y a aussi celle créée par des rangées de tombes. Avec sa série « Une ville dans la ville », projetée en partie à la Grande Orangerie du jardin de l’Arquebuse, l’architecte-urbaniste et photojournaliste Georges Harry Rouzier « met en débat le problème de l’urbanisation de la capitale haïtienne en prenant pour échantillon le cimetière de Port-au-Prince créé en 1770 » – soit 34 ans avant l’indépendance d’Haïti et 21 ans après la fondation de la ville.
« « Une ville dans la ville » est avant tout une restitution de l’histoire des architectures de Port-au-Prince, à travers le temps, par le biais de la forme des tombes et l’aménagement du cimetière. » – Voir l’article « Georges H. Rouzier : « Le cimetière de Port-au-Prince est une ville à part entière » », Ayibopost, 2020 / © Georges Harry Rouzier
Sur la première photo, une vue des caveaux du cimetière de Port-au-Prince. Sur la seconde, des commerces en bord de route.
Rien qu’au niveau du bâti, les deux villes se ressemblent. Mais ce n’est pas que sur des fondements esthétiques que l’analogie entre les deux « villes » est faite dans les travaux de Georges Harry Rouzier. Pour lui, le cimetière est le meilleur témoignage des problèmes socio-urbanistiques qui touchent la capitale depuis des décennies.
On dirait un cimetière de bâteaux après une tempête. Ce sont des cercueils entassés dans un coin du cimetière / © Georges Harry Rouzier
Voir l’article « Ces haïtiens qui habitent au cimetière de Port-au-Prince » (2019) sur Ayibopost / © Georges Harry Rouzier
C’est évident, ces photos rendent à la fois compte de l’urbanisation sauvage, de l’augmentation fulgurante de personnes sans-abris et de la gestion chaotique de ses défunts accentuées depuis le tremblement de terre de 2010. C’est sans doute la hauteur de ces tombes imposantes qui invitent les personnes les plus démunies à se cacher pour survivre.
Mini-ville au coeur de la grande ville, vue du ciel / © Georges Harry Rouzier
Aussi, le photographe tient à rappeler que ses photos ne portent pas sur la mort mais bien sur l’urbanisme. Le cimetière de Port-au-Prince est une véritable petite ville, nichée au coeur de la capitale.
« Même si le travail met l’accent sur l’architecture et l’urbanisme, il est frappant de constater qu’au cimetière de Port-au-Prince, la société telle quelle est reproduite. « Ici, dit Georges Harry Rouzier, il y a les quartiers des pauvres et les quartiers des riches. Le cimetière a son Pétion-Ville, son Turgeau, son Wout Nèf et son Cité-Soleil. Il y a les mêmes problèmes de loyer et de cadastre. » »
Les références de cette peinture nous échappent. Pour plus d’occurrences pop sur la vie dans les cimetières, fouillez donc dans nos archives
Malgré le fait qu’Haïti soit connue internationnalement pour ses cas avérés de zombies, les habitants qui peuplent aujourd’hui les ruelles du cimetière de Port-auPrince sont bel et bien des (sur)vivants.
Des transports bricollectifs
A Port-au-Prince, la survie et la débrouille ne sont pas l’apanage des habitants du champ du repos, loin s’en faut. C’est au contraire l’âme même de la ville entière. On la retrouve à chaque coin de rue, dans tous les secteurs de la vie citadine. Pour se déplacer par exemple, les Port-au-princiens et Port-au-princiennes utilisent principalement la moto comme mode de transport individuel… et collectif au grand dam des organismes de sécurité routière.
« La mototaxi est apparue dans le secteur du transport en commun en 1987, elle n’a jamais fait l’objet du moindre contrôle. Aujourd’hui, la moto est le moyen de transport numéro 1 en Haïti, le moyen le plus rapide, mais aussi le moins sûr. Les motocyclettes sur les routes haïtiennes tuent plus que certaines maladies. Les principes comme le port du double casque, deux personnes par motos y compris le passager ne sont guère respectés. » – Voir l’article « Mototaxis, le dernier visage du chaos en Haïti« , 2018
Même si cette photo a été prise dans un contexte particulier de soulèvement populaire, la moto en trio sans casque n’est pas une scène exceptionnelle de la ville haïtienne / © Johnson Sabin
Mais face aux mototaxis ultra dangereuses, un « vrai » moyen de transport collectif a su tirer son épingle du jeu en Haïti. Vous les avez sûrement déjà vues quelque part, ces camionettes-mini bus bricolées et peintes de couleurs vives, appelées « tap-tap ». Elles transportent généralement entre vingt et trente personnes (serrées comme des sardines5).
https://twitter.com/Badalssim/status/1058306381474906112
Bricolés et customisés à l’envi, ils ont un charme fou. Les messages et les images qui figurent sur leur carrosserie sont des concentrés de pop-culture internationale et de références à la culture haïtienne, de même que pour la musique que les les conducteurs se plaisent à diffuser via des haut-parleurs.
Dans ce reportage photo diffusé au sein de l’expo (dont on n’a pas su spécifié le nom du l’auteur parmi la liste des artistes), le/la photographe suit les artisans en charge de bricoler ces bus tape-à-l’œil de A à Z, comme ici avec la fabrication des sièges destinés aux passagers
« Apparus à la fin des années 1940, ces véhicules étaient des châssis-cabines d’une tonne et demie maximum, sur lesquels un carrossier local était intervenu selon des méthodes artisanales utilisant comme matériaux : du bois, de la tôle galvanisée, des pièces de fer pour les raccords, des clous, de la peinture à huile, de l »éponge ou du déchet de vétiver pour le rembourrage des sièges et du contreplaqué décoratif. Dans les années 2010, ces matériaux ne sont plus utilisés dans la fabrication des tap-tap. » – Voir la page Wikipédia dédiée aux tap-tap
Moins décriés que les mototaxis, les tap-tap ne sont pas non plus des exemples de légalité et de confort. Malgré tout, ce sont de véritables œuvres d’art qui font appel à des savoir-faire locaux transmis de génération en génération.
Le système D comme spécialité locale
C’est en réalité dans toute la gestion du quotidien, et à toutes les échelles de la société (commerce, logistique, transport de marchandise, mobilier urbain et domestique, santé, artisanat, religieux, administratif, etc.) que la débrouillardise et la créativité haïtiennes s’expriment, pour former une sorte d’expertise nationale absolument épatante. Le soin et la beauté de la fabrication des tap-tap vous ont subjugué.e.s ? Attendez de voir l’outillage, les équipements, les accessoires, la vaisselle, les jouets, les jeux, l’ameublement, les services et les magasins informels…
Carburants, produits ménagers, épicerie, pharmacie, tampons professionnels, bar ou salon de beauté : les petits stands de rue – fixes ou ambulants – pour se réapprovisionner / © Roberto Stephenson
De notre côté, on a découvert tout ce savoir-faire et cette esthétique bricolée grâce à la série de photos de l’haïtien Roberto Stephenson, nommée « Made in Ayiti ».
« Dans son projet Made in Ayiti, Roberto explore la réalité urbaine à travers des objets témoignant le génie de la débrouillardise à Port-au-Prince. Des objets fabriqués pour maintenir une survie qui semble s’éteindre peu à peu. Des objets imparfaits comme le quotidien à Port-au-Prince. Les imperfections racontent le vécu du peuple ; c’est toute l’histoire de l’homme haïtien qui y est écrite. Elles nous font prendre conscience de toute la dimension du hasard dans notre vie. » – « Made in Ayiti, objets de vie et regard du photographe Roberto Stephenson« , le national
Réparation électronique et numérique sous les yeux du divin. Voilà qui plaira à Nicolas Nova, en annexe de son bouquin sur les boutiques de réparation de smartphone / © Roberto Stephenson
On fait facilement le lien avec l’une des premières parties de notre article, celle consacrée à la rue comme théâtre du quotidien et de l’événementiel. Tous ces objets meublent et animent les rues de Port-au-Prince de différentes manières, qu’ils soient un stand en bord de route ou un jeu partagé à l’abri des mototaxis.
C’est là que les fictions d’anticipation post-apo à la Fallout et Mad Max prennent tout leur sens / © Roberto Stephenson
Les objets photographiés par Roberto Stephenson viennent d’horizons très divers mais sont tous le résultat d’une ingéniosité certaine et d’assemblages manuels. S’il témoigne d’un mode de vie ardu et d’un contexte de pauvreté extrême, cet artisanat du quotidien révèle tant d’adresse et de créativité qu’il mérite toute notre attention. Cette série photographique nous a tout simplement plongés dans un futur plausible et résilient où le survivalisme serait le maître mot de notre vie courante.
Voilà pour notre compte-rendu d’expo urbano-centré. On espère vous avoir dépaysés le temps de ce billet, et ouvert vos esprits sur cette ville et ce petit pays incroyables qui, malheureusement, souffrent depuis trop longtemps. Malgré le chaos ambiant (le président de la République d’Haïti Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet dernier et un nouveau séisme meurtrier a touché l’ouest de la capitale le 14 août), l’ensemble des artistes exposés montrent l’inventivité extraordianaire d’un peuple, et livrent un précieux message d’espoir et de résilience pour Haïti.
- Les artistes exposés : André Eugène, Guyodo, Olrich Exantus, Kbt, Ktl, Fritzgerald Muscadin, Basil Wesner, Jean Baptiste Getho, Prospère Pierre Louis, Payas, Paul F Do, Steven magloire, Robert St Brice, Wilbert, Jackson, Codet, Eddy Azor, Reno, Atis Aristoloche, Saint Fis [↩]
- Les artistes projetés et le nom de leurs séries photographiques : Georges Harry Rouzier : une ville dans la ville et musiques urbaines ; Josué Azor : Noctambules et Dualisme ; Fabienne Douce et Gianna Salomé : Pingüe ; Johnson Sabin : Petrocaribe, peyi bloke ; Roberto Stephenson : Made in Ayiti ; PauP_ante_2010 et Portraits ; Sébastien Denis : Lavi Kay Lanmo ; Verdyverda : plus plus ; Leah Gordon : Kanaval ; Sébastien Godret : histoires de murs. Lorsque l’auteur ou l’autrice n’est pas précisée en légende des photos qui illustrent le présent billet, se référer à cette liste mais nous avons parfois du mal à reconnecter les photos prises avec les noms de chaque série citée précédemment. On s’en excuse d’avance. [↩]
- Ce qui explique que parfois nous ne sommes plus sûrs de la série ou de l’auteur des photos et on s’en excuse d’avance. Tous les auteurs et autrices exposés ont été cités dans une note de bas de page en introduction. [↩]
- Ce qui explique aussi qu’on a parfois eu du mal à retrouver à quel artiste correspondait certaines photos en cherchant a posteriori. [↩]
- « La capacité théorique des tap-tap est de 14 personnes (12 à l’arrière et 2 dans la cabine) », nous dit Wikipédia [↩]